 Organisation
Organisation Internationale du Travail
 Organisation
Organisation
Internationale
du Travail
Votre
santé et votre sécurité au travail
DANGERS POUR LA FONCTION DE REPRODUCTION DE L'HOMME ET DE LA FEMME SUR LE LIEU DE TRAVAIL
But du module
Le présent module fournit aux stagiaires des renseignements de base sur la façon dont les risques professionnels peuvent être dangereux pour la reproduction tant chez l'homme que chez la femme. Les thèmes examinés sont les suivants: quand et comment apparaissent des problèmes de reproduction; comment un travailleur peut savoir si un produit chimique ou une situation professionnelle est dangereux pour sa fonction de reproduction; comment les travailleurs sont protégés; quel est le rôle du délégué à la santé et à la sécurité.
| Objectifs | |
 |
A la fin de ce module, les stagiaires pourront:
|
Table des matières
Des milliers de substances chimiques dangereuses sont produites et employées sur un grand éventail de lieux de travail partout dans le monde. Certaines de ces substances peuvent avoir des effets négatifs sur la fonction de reproduction tant chez l'homme que chez la femme qui y sont exposés. En outre, il existe divers facteurs physiques et biologiques (tels que les radiations et les bactéries) employés dans de nombreux lieux de travail qui exposent les travailleurs à des dangers additionnels pour leur fonction de reproduction. Enfin, de nombreuses situations professionnelles (telles que les métiers produisant beaucoup de stress ou le travail posté) peuvent avoir des effets négatifs sur la fonction de reproduction des travailleurs hommes et femmes.
Le risque de dommages pour la fonction de reproduction chez l'homme lié à la plupart des substances chimiques n'a pas encore été étudié. Malgré le manque d'information des éventuels effets sur la fonction de reproduction, de nombreuses substances sont toujours employées dans divers lieux de travail.
De nombreux travailleurs sont exposés à de tels risques tous les jours au travail. Le fait de travailler avec certaines substances ou dans certaines conditions peut entraîner des anomalies dans la vie sexuelle ou la fonction de reproduction des travailleurs. De nombreux travailleurs ne savent peut-être pas que ces problèmes peuvent être liés à des dangers auxquels ils sont exposés au travail. L'information disponible est minime, mais une grande partie de ce qu'on sait sur les effets des substances employées sur le lieu de travail sur la fonction de reproduction chez l'homme et la femme a été appris en étudiant des travailleurs exposés, leurs conjoints et leurs enfants.
Il importe que les travailleurs et les syndicats en apprennent le plus possible sur les substances employées sur leur lieu de travail lorsque l'information existe. Il convient de prendre des mesures de protection pour faire en sorte que les femmes enceintes et les travailleurs hommes ou femmes qui souhaitent avoir un enfant ne soient pas exposés à des dangers connus ou soupçonnés pour la fonction de reproduction.
Note: Si certaines des expressions employées ici vous sont inconnues, reportez-vous au glossaire qui figure à la fin de ce module.
Le système reproductif Les diverses fonctions du système reproductif chez l'homme et la femme sont régulées par des hormones spéciales relâchées dans le sang par la glande pituitaire et les gonades (les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme). |
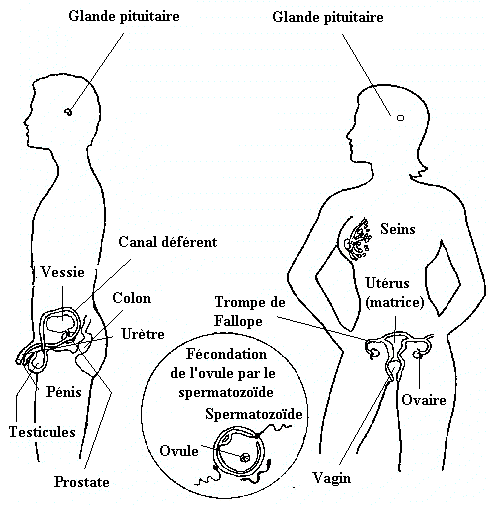 |
 |
Points à retenir |
Des milliers de substances chimiques dangereuses sont produites et employées sur un large éventail de lieux de travail partout dans le monde. Certaines de ces substances peuvent endommager la fonction de reproduction des travailleurs qui y sont exposés. Il y a aussi des facteurs physiques et biologiques et diverses situations professionnelles qui peuvent avoir un effet négatif sur la fonction de reproduction lorsque les travailleurs y sont exposés. On connaît mal les effets potentiels sur la fonction de reproduction de l'exposition à certaines substances, à certains agents ou à certaines situations professionnelles. Malgré le manque d'information, de nombreux travailleurs sont forcés à travailler avec des substances ou autres facteurs présentant un danger pour la fonction de reproduction. Les travailleurs et les syndicats doivent s'informer le plus possible sur les substances employées sur leur lieu de travail. Il convient de prendre des mesures de protection pour faire en sorte que les femmes enceintes et les travailleurs ou travailleuses qui prévoient d'avoir un enfant ne soient pas exposés à des dangers connus ou soupçonnés pour la fonction de reproduction. |
|
II. Quand et comment la fonction de reproduction est-elle endommagée?
L'exposition à certaines substances ou à certaines conditions de travail dangereuses peut avoir un effet sur la fonction de reproduction avant ou après la conception. Certains risques professionnels, en particulier ceux qui sont liés à certains produits chimiques et aux rayonnements, peuvent compromettre le développement de l'embryon ou du foetus. On trouvera à l'Appendice I à la fin de ce module des exemples de produits chimiques dont on sait qu'ils ont des effets négatifs sur le comportement sexuel et la reproduction.
Les effets négatifs dus à l'exposition peuvent aussi intervenir après la naissance et affecter le développement de l'enfant. Ces effets ne sont pas considérés comme des effets sur la fonction de reproduction, mais il importe de savoir que les nouveaux-nés et les enfants sont particulièrement exposés aux effets des substances dangereuses.
Mon mari se plaint que je suis rarement d'humeur à faire l'amour, est-ce que cela pourrait être dû aux produits chimiques que nous employons au travail?
Depuis que j'ai commencé à travailler ici je suis très stressée et mes règles sont devenues irrégulières.
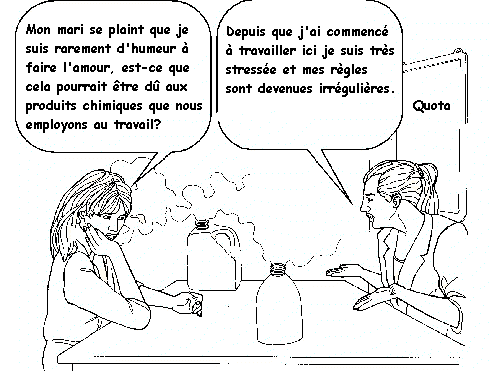
L'exposition à certains risques sur le lieu de travail peut empêcher la conception. L'exposition à certaines substances ou combinaisons de substances peut réduire le désir sexuel chez l'homme ou la femme, endommager les ovules ou les spermatozoïdes, modifier le matériel génétique transporté par les ovules et les spermatozoïdes ou provoquer des cancers ou autres maladies des organes reproductifs de l'homme et de la femme.
Certaines mutations peuvent entraîner uniquement des changements mineurs chez l'enfant. D'autres mutations ne produisent aucun effet visible. Toutefois, il importe de se souvenir que même s'il n'y a pas d'effets visibles ou de dommages chez l'enfant, la modification du matériel génétique est permanente. Ces modifications permanentes peuvent être transmises aux générations futures, chez lesquelles des modifications visibles pourraient apparaître.
Une substance qui entraîne une modification du matériel génétique est qualifiée de mutagène. Des analyses de laboratoire spéciales permettent d'identifier les substances mutagènes. Souvent, les substances sont testées sur des animaux pour voir si elles produisent des mutations.
Etablissez une liste des substances mutagènes employées sur votre lieu de travail. Pour cela, vous pouvez commencer par établir la liste des noms génériques des produits chimiques que vous employez et vérifiez dans les Appendices I et VI à la fin du présent module si elles y figurent. La plupart des produits chimiques cancérigènes (à l'exception de la plupart des solvants) sont des mutagènes. |
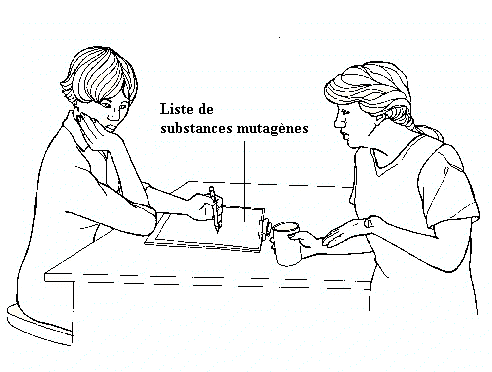 |
Une fois qu'il y a eu fécondation, certaines substances nocives peuvent passer de la mère à l'embryon. On pense généralement que le foetus est particulièrement exposé durant les 14 à 60 premiers jours de la grossesse, c'est-à-dire la période durant laquelle les principaux organes se forment. Toutefois, selon la nature et le degré de l'exposition, le foetus peut être endommagé à tout moment durant la grossesse. Par exemple, l'exposition à une substance donnée à un certain point de la grossesse peut entraîner un dommage à un organe alors qu'à un autre moment elle peut entraîner une fausse couche.
Il ne faut pas oublier que l'incidence normale des fausses couches et des défauts congénitaux varie selon le pays. Lorsqu'il y a défaut congénital ou fausse couche, il faut tenir compte des normes locales; toutefois, il ne faut jamais ignorer un cas qui est ou pourrait être lié à une exposition sur le lieu de travail.
Une substance qui empêche le développement normal d'un foetus est appelée tératogène. Les tératogènes peuvent passer du sang de la mère au sang du foetus à travers le placenta. Beaucoup de gens ont entendu parler de la thalidomide, médicament qui était employé pour prévenir la nausée durant la grossesse. On sait aujourd'hui que la thalidomide a des effets tératogènes. Toutefois, on ne savait pas lorsqu'elle a été utilisée pour la première fois et en conséquence des milliers d'enfants sont nés avec des membres déformés ou atrophiés car leur mère avait pris le médicament durant sa grossesse. Heureusement, on dispose maintenant d'essais qui permettent de détecter les effets tératogènes des médicaments avant qu'ils soient mis sur le marché.
Le cordon ombilical transporte le sang du foetus jusqu'au placenta où il se trouve à proximité du sang de la mère et des substances nutritives et les déchets sont échangés. C'est dans le placenta que les substances tératogènes peuvent être passées à l'embryon ou au foetus. |
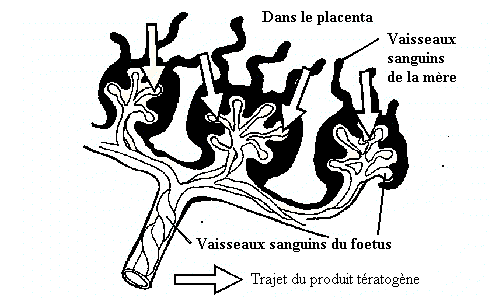 |
Les substances tératogènes sont des produits chimiques toxiques qui peuvent passer du sang de la mère au sang du foetus où elles ont un effet négatif sur le développement du foetus. |
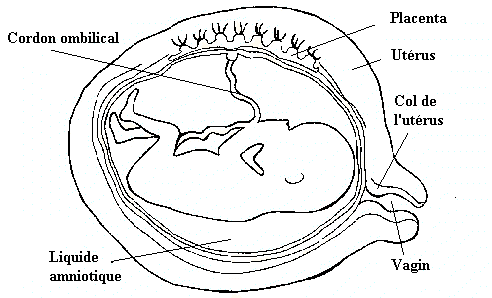 |
Il existe un certain nombre de produits chimiques, d'agents biologiques (bactéries) et de facteurs physiques (rayonnements) employés dans divers lieux de travail dont on sait qu'ils causent des défauts congénitaux. (On trouvera à l'Appendice VII à la fin de ce module des exemples de substances dont on a constaté qu'elles peuvent avoir des effets négatifs sur la reproduction s'il y a exposition durant la grossesse. Il importe toutefois de noter que les effets négatifs sur la reproduction ne sont pas nécessairement des défauts congénitaux.) Les défauts congénitaux peuvent comprendre tout un éventail d'anomalies physiques, telles que des déformations des os ou des organes et de problèmes de comportement ou d'apprentissage tels que l'arriération mentale.
Dans certains cas, des facteurs causant un stress, comme le travail répétitif, l'absence de pauses et les exigences constantes adressées aux femmes enceintes peuvent être directement liés à des naissances prématurées.
Les cigarettes, les médicaments, l'alcool, les rayonnements et le stress peuvent avoir un effet négatif sur le développement du foetus. |
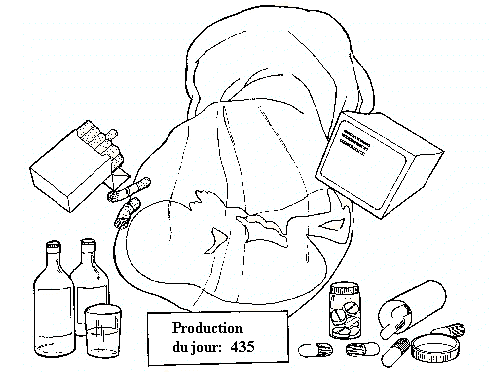 |
D'auteurs facteurs peuvent affecter la santé du foetus en développement, comme le stress à la maison, le tabagisme, la consommation d'alcool ou la prise de certains médicaments. En outre, ces facteurs peuvent se combiner avec des situations dangereuses sur le lieu de travail pour accroître ainsi le danger que court le foetus. Les femmes enceintes qui sont exposées à certains produits chimiques, rayonnements ou facteurs de stress au travail risquent aussi de donner naissance à des enfants présentant une insuffisance pondérale, ce qui peut entraîner des problèmes de développement physique et mental.
L'exposition à des dangers sur les lieux de travail peut aussi nuire au développement de l'enfant après sa naissance. Même s'il ne s'agit pas là directement de la fonction de reproduction, il importe de savoir que les nouveaux-nés et les enfants sont particulièrement vulnérables face aux effets des produits chimiques ou autres substances nocives qui peuvent être ramenés à la maison sur les vêtements, les chaussures ou même la peau et les cheveux. Par exemple, il est bien connu que les enfants longtemps exposés à de l'amiante ramené à la maison sur les vêtements présentent un risque accru de développement de maladies des poumons liées à l'amiante. Le lait maternel est une autre voie d'exposition pour les nouveaux-nés. Si des substances nocives sont présentes dans le lait maternel, les nouveaux-nés peuvent les absorber lors de l'allaitement.
Dangers pour la fonction de reproduction chez l'homme et la femme
Source: A. Hricko, M. Brunt: Working for your life: A woman's guide to job health hazards, publication commune du Labour Occupational Health Programme et du Public Citizens' Health Research Group, Berkeley, Californie, 1976.
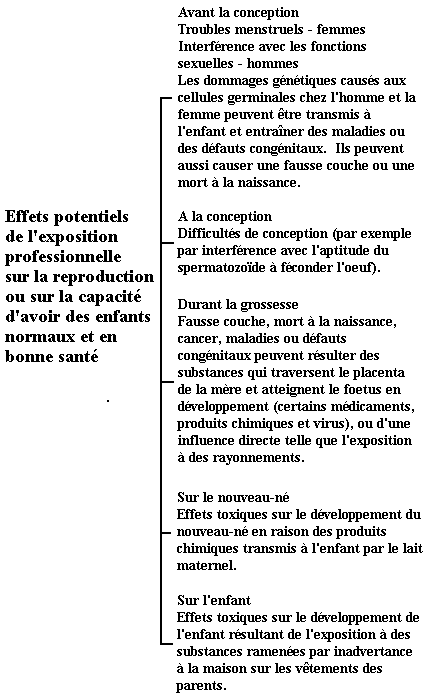
 |
Points à retenir à propos des dommages qui peuvent être causés à la fonction de reproduction, quand et comment |
|
|
III. Comment savoir si un produit chimique, un agent biologique, un facteur physique ou une condition de travail est dangereux pour la fonction de reproduction?
Il est très difficile de savoir exactement quels produits chimiques, produits biologiques, agents physiques ou conditions de travail auront des effets négatifs sur la fonction de reproduction des travailleurs hommes ou femmes. Malheureusement, la plupart des produits chimiques, des agents biologiques ou des facteurs physiques et des conditions de travail n'ont pas été suffisamment étudiés quant à leurs éventuels effets sur la santé humaine et la reproduction. En fait, de nombreuses substances employées sur divers lieux de travail n'ont pas été du tout étudiées.
Plusieurs facteurs importants déterminent si l'exposition à un produit chimique, un agent biologique ou un facteur physique ou à d'autres types de conditions de travail auront des effets négatifs sur la santé du travailleur. Ces facteurs sont les suivants:
En règle générale, le travailleur doit partir du principe que l'exposition régulière à tout agent chimique ou biologique peut être dangereuse pour sa fonction de reproduction et sa santé en général.
Les travailleurs et les syndicats doivent collaborer avec les employeurs pour éliminer totalement les expositions dangereuses ou en tout cas pour les ramener au niveau autorisé dans les normes reconnues sur le plan national ou international s'ils ne peuvent pas être éliminés.
On accumule peu à peu des renseignements sur les effets que peuvent avoir les risques professionnels sur la fonction de reproduction. Toutefois, à ce jour, l'information disponible sur de nombreuses substances employées ou produites sur de nombreux lieux de travail reste insuffisante. Lorsqu'on sait que l'exposition à un danger ou à une combinaison de dangers peut avoir un effet sur le foetus, aucune femme enceinte ne devrait y être exposée si peu que ce soit. Cependant, les travailleurs et les syndicats doivent veiller à ce que les mesures prises ou les politiques mises en oeuvre pour protéger les travailleurs n'entraînent pas de discrimination à l'égard des femmes.
Les employeurs devraient fournir aux travailleurs une formation détaillée sur les éventuels risques liés aux produits avec lesquels ils travaillent. Il convient que les travailleurs soient informés des dangers connus de certains produits chimiques et combinaisons de produits chimiques, des limites d'exposition recommandées et des méthodes de protection recommandées. (Pour plus de précisions, voir les modules intitulés Les produits chimiques sur le lieu de travail et Maîtrise des risques.)
La formation concernant la fonction de reproduction et les risques qu'elle peut courir sur le lieu de travail est importante pour tous les travailleurs. |
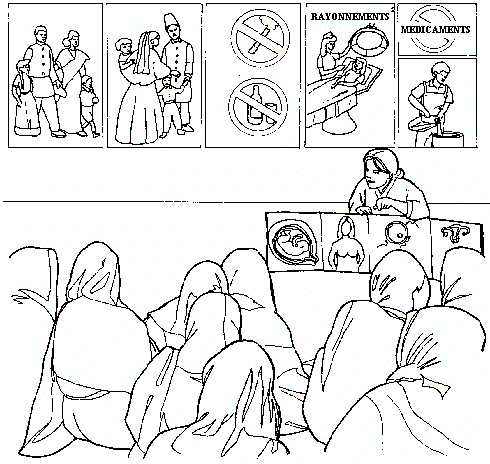 |
 |
Points à retenir pour savoir si un produit chimique ou une situation professionnelle est dangereux pour votre fonction de reproduction |
|
|
IV. Protection de la fonction de reproduction
Pour protéger la fonction de reproduction de tous les travailleurs, il faut éliminer l'exposition aux produits chimiques, aux rayonnements, aux agents biologiques et aux conditions de travail stressantes ou en tout cas la réduire autant que possible. Il convient d'éliminer totalement les substances mutagènes, tératogènes et cancérigènes ou de les isoler pour qu'elles entrent moins en contact avec les travailleurs et le milieu de travail.
Certaines industries ont adopté diverses approches générales pour protéger la fonction de reproduction des travailleurs contre les expositions sur les lieux de travail. Cependant, nombre de ces approches ne sont pas souhaitables et sont en fait discriminatoires.
Bien entendu, l'approche la plus contestable est celle qui consister à laisser les travailleurs exposés à des facteurs dangereux pour leur fonction de reproduction sans aucun contrôle ou précaution.
Politiques d'exclusion
De nombreuses industries ont pris divers types de mesures pour protéger les travailleurs. Souvent, la mesure consiste à refuser l'embauche ou à transférer les travailleurs jugés les plus exposés aux dangers pour la fonction de reproduction, c'est-à-dire les femmes en âge d'avoir des enfants. (Il a souvent été soutenu que de telles politiques ne visent pas à protéger les travailleurs mais à protéger l'employeur contre d'éventuels procès ultérieurs.) Les politiques consistant à exclure les femmes de certaines tâches sont souvent appliquées d'une façon qui n'est cohérente ni uniforme. Par exemple, on applique une politique d'exclusion pour des tâches dont les femmes étaient de toute façon traditionnellement exclues, alors qu'on ne le fait pas dans certaines industries dans lesquelles les femmes ont toujours été et constituent encore une partie importante de la main-d'oeuvre. Dans de telles industries, les femmes sont souvent employées malgré le risque d'exposition à des facteurs dangereux pour la fonction de reproduction. Par exemple, alors que les techniciens des rayons X, les esthéticiennes, les nettoyeurs à sec et les blanchisseurs ainsi que le personnel des salles d'opérations sont exposés à des substances qui peuvent affecter la reproduction, les femmes ne sont généralement pas exclues de ces métiers.
Un des grands problèmes que posent les politiques d'exclusion des femmes est qu'elles établissent une discrimination à l'égard des femmes en âge de procréer en leur refusant certains emplois alors que les hommes sont toujours exposés à ces dangers dans les mêmes emplois. Il est essentiel de s'intéresser aussi aux problèmes de reproduction qui affectent les hommes. Malheureusement, les effets des risques professionnels sur la reproduction chez l'homme n'ont guère été étudiés à ce jour.
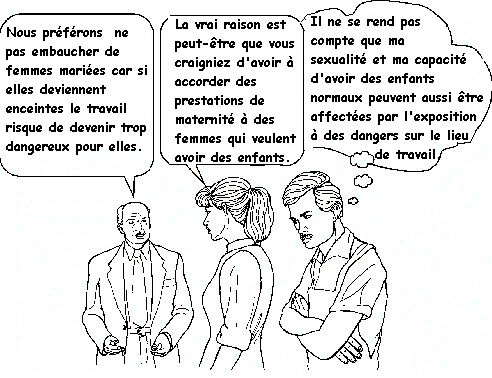
Politiques de mutation
Certaines industries ont mis en oeuvre des politiques de mutation qui permettent de changer d'affectation les femmes qui risquent d'être exposées durant une période de grossesse ou lorsqu'elles envisagent de devenir enceintes. Ces politiques peuvent être valables jusqu'à ce que le lieu de travail puisse être rendu sûr du point de vue de la reproduction ou lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés. Toutefois, les politiques de mutation doivent aussi être conçues de façon à protéger les hommes qui envisagent d'avoir un enfant.
Si l'on adopte une politique de mutation, elle ne doit pas s'accompagner de perte de salaire ni de déclassement professionnel. Le maintien du salaire garantit au travailleur qu'il n'est pas pénalisé en cas de grossesse ou lorsqu'il exprime le souhait d'avoir un enfant en étant forcé de prendre un emploi moins payé. De même, après la grossesse, la travailleuse doit avoir le droit de retrouver son ancien poste.
Malheureusement, sur de nombreux lieux de travail, on se contente de licencier tout simplement les femmes en âge de procréer ou enceintes au lieu de leur offrir un autre emploi non dangereux. Comme la famille est généralement tributaire de son revenu, la femme enceinte ou en âge de procréer n'a souvent pas le choix et doit continuer à travailler, même si cela signifie qu'elle s'expose ou qu'elle expose son enfant à venir à des risques, lorsqu'un aucun autre emploi ne lui est offert. Dans un tel cas il n'y a pas de véritable choix pour le travailleur. Dans le cas des travailleurs hommes, la politique est la même, mais les risques sont moins apparents et on tend donc à les sous-estimer.
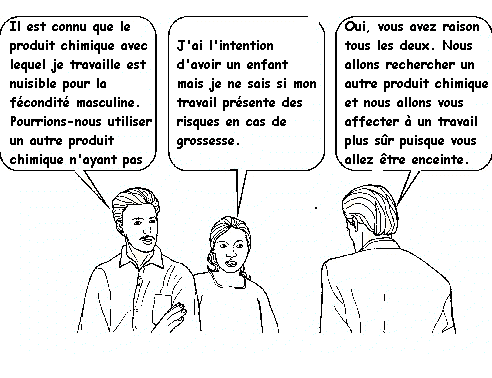
Il n'existe pas de solution unique aux problèmes des dangers pour la fonction de reproduction et de l'exclusion de certains groupes de travailleurs. Dans de nombreux pays, des syndicats, des groupements de défense de l'intérêt général, des savants et des représentants du gouvernement s'attaquent à ce problème depuis de nombreuses années. Bien que certains pays aient fait des progrès en adoptant des lois et des règlements et en créant des organismes publics, il reste encore beaucoup à faire pour assurer la protection complète de la santé de tous les travailleurs en matière de reproduction.
Que faut-il faire?
Les gouvernements doivent agir. Ils doivent:
Les travailleurs, les délégués à la santé et à la sécurité et les syndicats doivent aussi agir. Ils peuvent:
Les travailleurs et leurs syndicats doivent s'employer à faire en sorte que tout lieu de travail soit sain et sûr. Ce n'est qu'ainsi que les travailleurs pourront être certains que les dangers auxquels ils sont exposés sur le lieu de travail ne nuiront pas à leur fonction de reproduction ou à la santé de leurs enfants nés ou à naître.
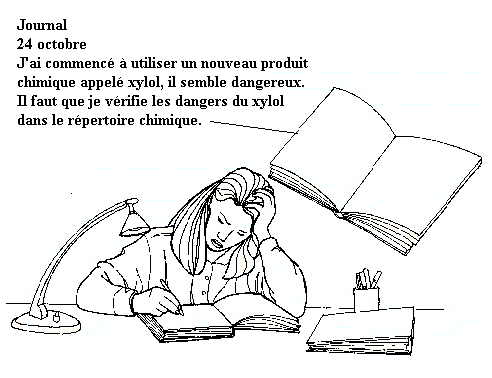
La tenue d'un registre et l'organisation de discussions en groupe peuvent aider à détecter des anomalies du comportement sexuel et des problèmes de reproduction. |
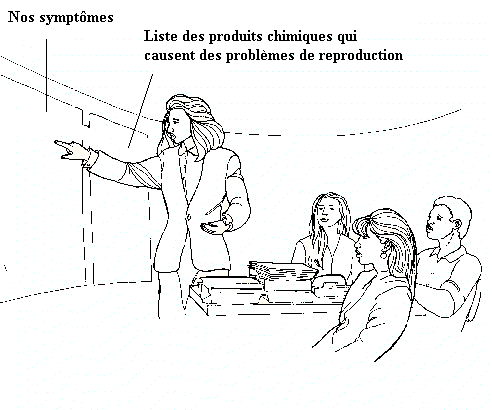 |
 |
Points à retenir à propos de la fonction de reproduction |
|
|
V. Rôle du délégué à la santé et à la sécurité
En tant que délégué à la santé et à la sécurité vous pouvez jouer un rôle important s'agissant d'aider à faire en sorte que le travail ne compromette pas les fonctions de reproduction des travailleurs hommes ou femmes. Vos efforts dans les domaines de l'éducation des travailleurs, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, du contrôle des substances et des conditions de travail et de la tenue de registres aideront à atteindre cet objectif. Voici quelques mesures à prendre pour atteindre ces objectifs:
Délégué à la santé et à la sécurité |
 |
Note: Il importe que les délégués à la santé et à la sécurité soient informés de tous les problèmes existants. Cependant, vous devez être conscients que ces questions sont délicates pour beaucoup de travailleurs. De nombreux travailleurs ne veulent pas parler de problèmes liés à leur fonctionnement sexuel, à leur cycle menstruel, à leur capacité de concevoir, etc. Vous devrez donc déterminer des méthodes appropriées pour obtenir des renseignements sur ces questions délicates en tenant compte des caractéristiques de la main-d'oeuvre et des habitudes locales.
| VI. Résumé | |
 |
|
 |
Exercice. Un cas d'infécondité masculine due à l'exposition à un produit chimique au travail Source: Occupational health, publié la direction de Barry S. Levy et David H. Wegman, Little, Brown and Company, Boston/Toronto, 1983. Note pour l'instructeur La description ci-après concerne un cas réel; il s'agit d'une des épidémies les mieux étudiées des problèmes de reproduction chez l'homme dus aux conditions de travail. Cette épidémie a été étudiée aux Etats-Unis en 1977 parmi des hommes travaillant dans la production de pesticides. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un tableau à feuillets mobiles ou de grandes feuilles de papier collées au mur et de feutres ou d'un tableau noir. Instructions Lisez l'étude de cas à l'ensemble de la classe. Demandez aux participants de prendre des notes sur les points importants. Lorsque vous avez fini la lecture de l'étude de cas, demandez aux participants de travailler en petits groupes de trois à cinq pour examiner la situation. Demandez au groupe de suggérer des façons dont on aurait pu traiter la situation lorsqu'on s'est aperçu que le produit chimique appelé DBCP était la cause des problèmes de fécondité. La description du cas est suivie de plusieurs questions que le groupe pourra examiner et discuter. Les groupes devront exposer leurs réponses à l'ensemble de la classe. Vous pouvez noter les principales idées de chaque groupe sur le tableau. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions qui suivent, celles-ci sont simplement proposées pour alimenter le débat. Lorsque la classe a examiné les idées de tous les groupes, donnez lecture du dernier paragraphe de l'étude de cas. Dernier paragraphe de l'étude de cas Mesure prise Sur la base des conclusions de cette étude, l'utilisation du DBCP (mais pas sa fabrication) a été interdite par l'Environmental Protection Agency dans les Etats continentaux des Etats-Unis (il est toujours utilisé à Hawaii). Le seul autre pesticide dont on a constaté jusqu'à présent qu'il a des effets similaires sur la fonction de reproduction chez l'homme est le képone (chlordécone). Le cas Un homme de 30 ans travaillant dans la production de pesticides est allé voir son médecin pour lui dire que malgré plusieurs tentatives d'avoir un second enfant sa femme ne pouvait pas devenir enceinte. Un examen médical a montré qu'il n'y avait pas de spermatozoïdes dans son éjaculat. L'examen médical de sa femme n'a rien fait apparaître d'anormal. Le travailleur a dit à son médecin qu'il était exposé à plus de 100 produits chimiques au travail. Le médecin a estimé qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires ni le temps voulu pour évaluer l'exposition à ces différents produits chimiques. Lorsque le travailleur a commencé à parler de ce problème avec ses collègues, il a appris qu'il y avait d'autres couples qui avaient aussi été incapables de concevoir. Après avoir examiné le problème avec ses collègues, il a finalement convaincu cinq d'entre eux de fournir des échantillons de sperme pour analyse. L'analyse a montré qu'il n'y avait pas du tout de spermatozoïdes ou très peu dans chacun des cas. Ces résultats ont été envoyés à un autre médecin qui avait déjà travaillé comme consultant pour le syndicat local. Le médecin, qui n'avait jamais vu les hommes auparavant, les a examinés et a refait les analyses de sperme avec les mêmes résultats. D'autres analyses ont été effectuées sur les testicules de plusieurs des travailleurs affectés. Les résultats ont indiqué que l'absence ou la faible concentration de spermatozoïdes était un effet direct de l'exposition à des produits chimiques toxiques sur le lieu de travail. Parmi les 100 produits chimiques utilisés dans l'usine, des études sur l'animal avaient montré que quatre d'entre eux étaient toxiques pour la fonction de reproduction chez le mâle. Comme le 1,2,-dibromo-3-chloropropane (DBCP) était le principal produit chimique fabriqué dans l'usine, on a soupçonné qu'il était la cause des problèmes de ces hommes. Deux autres usines produisant du DBCP ont évalué leurs travailleurs et trouvé des résultats similaires. L'association entre le problème de fécondité et l'exposition au DBCP a été renforcée lorsqu'on a constaté que c'était le seul produit chimique auquel les travailleurs des trois usines étaient tous exposés. Questions
|
Source: Health hazards in the electronics industry, Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong, 1985.
Conception: moment auquel l'ovule est fécondé par un spermatozoïde et commence à croître; commencement d'une nouvelle vie, commencement d'une grossesse. |
Cycle menstruel: cycle de la fécondité, qui dure en moyenne 28 jours et est géré par la sécrétion de certaines hormones dans le corps de la femme. Le cycle commence par une période de menstruations de deux à cinq jours (épanchement de sang et de cellules tapissant l'utérus) suivi vers le quatorzième jour (milieu du cycle) par une ovulation (libération d'un oeuf) qui se déplace à partir d'un des ovaires le long d'une trompe de Fallope jusqu'à l'utérus où il reste pendant environ une semaine. Si l'ovule n'a pas été fécondé par le sperme d'un homme durant les quelques jours qui suivent l'ovulation, des changements hormonaux entraînent une menstruation et le début d'un nouveau cycle. |
Congénital: qualifie un problème présent ou qui apparaît à la naissance. |
Mutagène: se dit d'un agent, comme certains produits chimiques ou rayonnements ionisants, qui peut entraîner une mutation; il existe environ 2 000 substances ou facteurs mutagènes connus ou soupçonnés. |
Embryon: nom donné à l'enfant avant la naissance entre le moment de la conception et la fin de la huitième semaine de croissance dans l'utérus, après quoi il est appelé foetus jusqu'à la naissance. |
Mutation: changement irréversible de la structure d'un chromosome ou d'un gène dans une cellule causé par une substance chimique étrangère ou par un rayonnement ionisant. Ce changement a généralement un effet négatif sur la croissance et la fonction des cellules. Les cellules sexuelles (spermatozoïdes et ovules) endommagées par un mutagène peuvent transmettre des traits indésirables aux descendants pendant un nombre indéfini de générations. |
Foetus: nom donné à l'enfant avant la naissance après qu'il ait dépassé le stade de l'embryon, c'est-à-dire à partir de la huitième semaine à compter de la date de conception. |
Ovules: cellules reproductives de la femme présentes à la naissance et qui sont normalement relâchées à raison de une par mois par les ovaires. |
Gène: séquence d'ADN (acide désoxyribonuéclique) qui, en tant qu'unité fonctionnelle unique, porte un code spécifique qui détermine comment une cellule croît. Ainsi, ce sont les gènes de chaque cellule qui transmettent les caractéristiques héréditaires ou traits. Les gènes peuvent être endommagés (mutation) ou détruits par certains produits chimiques et par les rayonnements ionisants. L'ADN seul ou combiné avec d'autres molécules constitue une cible pour la destruction de la cellule. Comme l'ADN contient l'information génétique essentielle pour la vie des cellules filles, les dommages causés par les rayonnements à l'ADN sont un facteur important de destruction des cellules. |
Spermatozoïdes: cellules reproductives masculines produites continuellement dans les testicules. |
Tératogène: se dit d'une substance toxique pouvant traverser le placenta et se transmettre du sang de la mère au sang de l'embryon ou du foetus et entraîner une fausse couche, des défauts congénitaux ou une maladie. |
Appendice I.
Produits chimiques ayant des effets toxiques sur la reproduction
La liste ci-après est une liste de substances employées ou présentes dans l'industrie électronique qui compromettent l'aptitude des hommes et des femmes à avoir une vie sexuelle normale et des enfants normaux:
Source: Health hazards in the electronics industry, Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong, 1985.
| Nom chimique | Tératogène | Fécondité réduite ou stérilité | Fausse couche ou mort du foetus | Défauts congénitaux, mutations, dommages au foetus | Cancer des organes reproductifs | Problèmes menstruels |
| Acide éthylène-diamino tétracétique | A | |||||
| Acrylonitrile | A | ? | ||||
| Antimoine | A | H A | H | ? | H | |
| Arsenic | H s | H | A | H | ||
| Benzène | A | H si | A | ? | H | |
| Biphényles polychlorés | A | H | H | ? | ||
| Cadmium | H A si | H | H | H | ||
| Chlorobenzène | A | A | ? | |||
| Chloroforme | A | ? | ||||
| Chlorure d'éthylidène | A | |||||
| Chlorure de méthylène | H | |||||
| Chlorure de vinyle | H | H | H | H/A | ? | |
| Chlorure de zinc | A | ? | ||||
| Dibromure d'éthylène | H A s | H/A | H/A | ? | ||
| Dichlorure d'éthylène | H | H | H | ? | ||
| Diméthylformamide | A | |||||
| Dioxyde de carbone | H A | |||||
| Disulfure de carbone | H A si | H/A | H/A | |||
| Epichlorhydrine | H A s | ? | ||||
| Ether de diglycidyle | A | ? |
| Fréon 31 (chlorofluorométhane) | A | |||||
| Hydrocarbures chlorés Cellosolve (plusieurs types) | H/A | ? | ||||
| Lithium | A | |||||
| Manganèse | H si | ? | ||||
| Mercure | H A si | H/A | H/A | |||
| Méthyléthylcétone | H | |||||
| Métracrylate de méthyle | A | |||||
| Monoxyde de carbone | H si | H A | ||||
| Nickel | A | ? | ||||
| Oxyde d'éthylène | A | A | ? | |||
| Oxydes nitreux | H/A | H/A | ||||
| Perchloréthylène | A | ? | ||||
| Phosphore | H s | |||||
| Plomb | H A si | H | H | ? | H | |
| Sélénium | A | |||||
| Telludum | A | |||||
| Tétrachlorure de carbone | A | A | ? | |||
| Toluène | A | A | H | |||
| 1,1,1-trichloroéthane | A | A | ||||
| Trichloroéthylène | H si | H | H A | ? | ||
| Xylène | A | A | H | |||
| Radiations | H A | H A | H A | H | ||
| Travail posté | H |
H = Preuves chez l'homme A = Preuves chez l'animal H/A = Preuves chez l'homme et chez l'animal
s = causerait une stérilité chez l'homme i = associé à l'impuissance masculine
? = cause des cancers à d'autres parties du corps
Sources de l'Appendice I
Sources de l'Appendice I (citées dans la source primaire).
Chemical Hazards to Human Reproduction, Washington DC, Council on Environmental Quality (U.S. Government), janvier 1981.
Dapson et al: "Effect of methyl chloroform on cardiovascular development in rats", in Teratology, vol. 29, n° 2, avril 1984, pages 25A.
1979 Registry of toxic effects of chemical substances, volumes 1 et 2, Publication n° 80-111, National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, Ohio, U.S. Department of Health & Human Services, 1980.
Guidelines on Pregnancy and Work, Publication n° 78-118, National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, Ohio, U.S. Dept. of Health and Human Services, 1978.
"Reproductive hazards in the electronics industry", in Factsheet No 2, Project on Health and Safety in Electronics, 1979, Santa Clara, Californie.
Plunkett, E.R. et al: Occupational diseases: A syllabus of signs and symptoms, Barret Co., Stamford, Connecticut, 1977.
Stellman, J.: "The effects of toxic agents on reproduction", in Occupational Health and Safety, pages 37-43, Etats-Unis, avril 1979.
Appendice
II.
Risques pour la reproduction chez l'homme et la femme
Source: Clinical occupational medicine, par L. Rosenstock et M.R. Cullen, W.B. Saunders Company, Londres, 1986.
Causes |
Effets |
| Dangers prouvés pour la reproduction (sur la base d'études chez l'homme) | |
| Gaz anesthésiques Diéthylstilbestrol (DES) Hépatite B Mercure organique Plomb Biphényles polychlorés (PCB) Rayonnements |
Fausse couche, décès
du nouveau-né Cancer Hépatite du nouveau-né, cancer du foie Paralysie cérébrale, malformation du cerveau Fausse couche, naissance prématurée Insuffisance pondérale à la naissance Fausse couche, défaut du cerveau, défaut du squelette |
| Dangers soupçonnés (sur la base d'études chez l'homme) | |
| Monoxyde de carbone Médicaments cytoxiques Oxyde d'éthylène Héxachlorophène Solvants organiques Stress physique (y compris la chaleur) 2,4,5 trichlorophénol Chlorure de vinyle |
Ralentissement de la
croissance Fausse couche Fausse couche Défauts congénitaux Bec de lièvre, fausse couche, infection du nouveau-né, cancer de l'enfant Naissance prématurée Fausse couche Défaut du cerveau |
| Dangers soupçonnés (sur la base d'études sur l'animal) | |
| Acrylonitrile Arsenic Cadmium Dioxyne Ethers de glycol Mercure inorganique Pesticides organochlorés Biphényles polybromurés (PPB) |
|
Appendice
III.
Produits chimiques affectant la fonction de reproduction chez l'homme et chez la femme
Source: Clinical occupational medicine, par L. Rosenstock et M.R. Culle, W.B. Saunders Company, Londres, 1986.
| Facteurs ayant un effet démontré sur le sperme |
| Produits chimiques |
| Carbaryl Disulfure de carbone Médicaments cytoxiques DBCP Plomb Toluène-2,4-diamine et ditrotoluène |
| Autres |
| Chaleur Rayonnements |
| Produits chimiques soupçonnés d'endommager le sperme* |
| Arsenic Benzène 3-,4-benzopyrène Bore Cadmium Chloroprène Epichlorhydrine Dibromure d'éthylène Ethers d'éthylène glycol Oxyde d'éthylène Halothane Képone Mercure Oxyde nitreux PPB Trichloroéthylène Triéthylèneamine *(Principalement sur la base d'essais sur l'animal.) |
Appendice
IV.
Industries dans lesquelles on a constaté un risque accru de perturbations de la
fonction de reproduction chez la femme exposée, sans avoir établi de liens avec des
expositions particulières
Source: Preventing occupational disease and injury, publié sous la direction de J.L. Weeks, B.S. Levy, G.R. Wagner, American Public Health Association, Washington, DC, 1991.
| Industries | Effets signalés |
| Industrie du caoutchouc Industrie du cuir Industrie chimique Industrie électronique (soudeuses) Métallurgie Travail de laboratoire Construction Transport Communication Agriculture et horticulture Travaux exposant à des solvants mélangés Textiles |
Avortement spontané Avortement spontané Avortement spontané Avortement spontané Avortement spontané Avortement spontané, défauts congénitaux Défauts congénitaux Défauts congénitaux Défauts congénitaux Défauts congénitaux Défauts congénitaux, avortement spontané Avortement spontané |
Appendice V.
Exemples d'agents toxiques pour la fonction de reproduction chez le mâle
Source: Environmental and occupational medicine, publié sous la direction de W.N. Rom, Little, Brown and Company, Boston, 1983.
Agents chimiques |
Espèce
sur laquelle l'effet a été observé |
Exemples de métiers dans lesquels ce risque peut exister |
| Alcool | h | Risque social |
| Agents alkylants | h, a | Fabrication de produits chimiques et de médicaments |
| Gaz anesthésiques, oxyde nitreux | a, h | Travailleurs des professions médicale, dentaire et vétérinaire |
| Cadmium | h, a | Batteries d'accumulateur, travailleurs des fonderies |
| Disulfure de carbone | h, a | Fabrication de rayonne et de viscose, traitement du sol |
| Tétrachlorure de carbone | a | Laboratoires chimiques, nettoyage à sec |
| Diéthylstilbestérol (DES) | a, h | Fabrication de DES |
| Chloroprène | h, a | Travailleurs du caoutchouc |
| Oxyde d'éthylène | a, h | Travailleurs de la santé (désinfectant), utilisateurs de résines d'époxyde |
| Teintures pour cheveux | a | Fabricants de cosmétiques, coiffeurs et barbiers |
| Plomb | h, a | Batteries d'accumulateur, policiers, travailleurs des fonderies |
| Manganèse | h | Soudeurs, fonte et grillage de minerai |
| Nickel | a | Soudeurs, fondeurs |
| Composés organiques du mercure | a | Travailleurs de l'industrie des pesticides |
| Tris (retardateurs de feux) | a, h | Textiles et vêtements |
| Pesticides | a, h | Travailleurs agricoles, fabrication de pesticides, épandeurs |
| Dibromochloropropane | (DBCP) | Désinfestation |
| Képone | ||
| DDT | ||
| Carbaryl | ||
| DDVP | ||
| Malathion | ||
| Chlorure de vinyle | h | Fabrication et transformation du polyvinyle de chlorure |
| Facteurs physiques | ||
| Forte teneur en dioxyde de carbone | a | Travailleurs des brasseries, fabrication de produits chimiques |
| Températures élevées | h, a | Boulangers, souffleurs de verre, travailleurs des fonderies et des fours |
| Micro-ondes | h, a | Opérateurs de radars, pilotes, opérateurs d'émetteurs |
| Irradiations aux rayons X | h, a | Travailleurs de la santé, travailleurs exposés à des rayonnements |
Appendice VI.
Produits chimiques cancérigènes dans la fabrication de produits électroniques
Source: Health hazards in the electronics industry, Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong, 1985.
Liste partielle des produits chimiques employés ou présents dans la fabrication de produits électroniques et qui, selon les experts médicaux, causent ou sont soupçonnés de causer un cancer chez l'homme ou chez l'animal.
Produits chimiques |
Hommes |
Animaux |
| Acide borique | S |
S |
| Acide chromique | Oui |
Oui |
| Acrylate d'éthyle | S |
S |
| Acrylonitrile | Oui |
Oui |
| Alcool éthylique* | S |
Oui |
| Alcool isopropylique** | S |
S |
| Alcool propylique | S |
Oui |
| Amiante | Oui |
Oui |
| Amines aromatiques (teintures) | Oui |
Oui |
| Anhydride maléique | S |
S |
| Antimoine | S |
S |
| Argent | S*** |
|
| Arsenic (et composés) | Oui |
S |
| Arsine | Oui |
S |
| Benzène | Oui |
S |
| Benzidine | Oui |
Oui |
| Béryllium et composés | S |
Oui |
| Biphényles polychlorés | S |
Oui |
| Cadmium et composés | Oui |
Oui |
| Chloroforme | S |
Oui |
| Chlorotoluène | S |
Oui |
| Chlorure de benzyle | S |
Oui |
| Chlorure de vinyle | Oui |
Oui |
| Chlorure de zinc | S |
S |
| Chromates | Oui |
Oui |
| Chrome (et composés) | Oui |
Oui |
| Cobalt | S |
Oui |
| Dibromure d'éthylène | S |
Oui |
| Dichlorobenzène | S |
S |
| 3,3'dichlorobenzidine (et ses sels) | S |
Oui |
| a,a-dichlorométhyle éther | S |
S |
| Dichlorure d'éthylène | S |
Oui |
| Diépoxybutane | S |
Oui |
| Diéthylamine | S |
Oui |
| 1,4-dioxane | S |
Oui |
| Dioxyde de titane | S |
S |
| Dioxyde de vinylcyclohexène | S |
Oui |
| Diphényles | S |
S |
| Diphényles chlorés | S |
S |
| Epichlorhydrine | S |
Oui |
| Ether de bisphénol A et de diglycidyle | S |
Oui |
| Ether de diglycidyle | S |
S |
| Ether de digylcidyle triéthylèneglycol | S |
Oui |
| Ether di(chlorométhylique) | Oui |
Oui |
| Ethylène-imine | S |
Oui |
| Fibres de verre (cristallin) | S |
S |
| Formaldéhyde | S |
Oui |
| Hydrocarbures chlorés | S |
S |
| Manganèse | S |
S |
| Méthacrylate de méthyle | S |
S |
| Moca [4,4'-méthylènebis(2-chloroaniline)] | S |
Oui |
| Nickel (et ses composés) | Oui |
Oui |
| Or | S*** |
|
| Oxyde d'éthylène | S |
S |
| Oxyde de styrène | S |
S |
| Perchloréthylène | S |
S |
| Phénol | S |
S |
| Platine | S*** |
|
| Plomb (et ses composés) | S |
Oui |
| Polymères (matières plastiques): | ||
|
S |
S |
|
S |
Oui |
|
S |
Oui |
|
S |
Oui |
|
S |
Oui |
| Rayonnements: | ||
|
Oui |
Oui |
|
S |
S |
|
Oui |
Oui |
|
Oui |
Oui |
| Sélénium (et ses composés) | S |
S |
| Silice; quartz (cristallin) | S*** |
|
| Styrène | S |
S |
| Tétrachlorure de carbone | S |
Oui |
| Tétrafluoréthylène | S |
S |
| 1,1,1 trichloroéthane | S |
S |
| Trichloroéthylène | S |
Oui |
| Trioxyde de molybdène | S |
Oui |
Oui = preuve suffisante d'effets cancérogènes;
S = effets cancérogènes soupçonnés (soupçonné signifie soit qu'il y a certains
éléments de preuve mais insuffisants pour que les conclusions soient définitives, soit
qu'il y a certains éléments de preuve d'effets cancérogènes chez l'animal et que nous
devons par conséquent soupçonner qu'il y a un risque pour l'homme).
*Probablement dû à des contaminants qui pourraient agir comme cocancérigènes.
**La fabrication d'alcool isopropylique présente un risque certain de cancer chez
l'homme.
***Par implantation uniquement.
Appendice
VII.
Exemples de substances dont on a constaté qu'elles avaient des effets négatifs sur
la reproduction en cas d'exposition durant la grossesse
Source: Environmental and occupational medicine, publié sous la direction de W.N. Rom, Little, Brown and Company, Boston, 1983.
| Substance | Métiers exposés |
| Agents alkylants | Travailleurs de l'industrie pharmaceutique |
| Gaz anesthésiants* | Personnel de salles d'opérations (y compris dans la médecine dentaire et vétérinaire) |
| Arsenic | Travailleurs agricoles |
| Benzène | Travailleurs de l'industrie chimique, techniciens de laboratoires |
| Monoxyde de carbone | Personnes travaillant à l'extérieur, bureaux dans lesquels il y a des fumeurs |
| Hydrocarbures chlorés | Travailleurs de laboratoires, artisans |
| Diéthylestilbestrol* | Travailleurs de l'industrie pharmaceutique |
| Sulfoxide de diméthyle | Travailleurs de laboratoires |
| Dioxine* | Travailleurs agricoles |
| Agents infectieux | Travailleurs des professions médicales, assistants sociaux, enseignants, personnes qui s'occupent d'animaux, bouchers, inspecteurs, travailleurs des blanchisseries |
| Virus de la rubéole* | |
| Cytomégalovirus | |
| Herpes virus hominis | |
| Toxoplasmose | |
| Syphilis* | |
| Rayonnements ionisants | Techniciens des rayons X, travailleurs de l'industrie atomique, travailleurs de l'industrie pharmaceutique |
| Composés organiques du mercure | |
| Pesticides d'organophosphate | Travailleurs agricoles |
| DFP | |
| Parathion | |
| Captan | |
| Carbaryl | |
| Theram | |
| Biphényles polychlorés* | Travailleurs de l'électricité, opérateurs de microscopes (huile d'immersion) |
*Effets chez l'homme observés.